Introduction aux études sur le genre | Laure Bereni
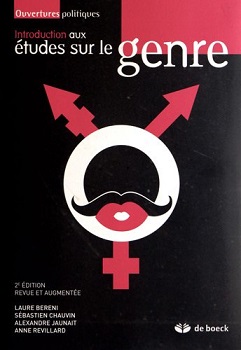 Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons ? Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes ? Comment expliquer qu'elles effectuent les deux tiers du travail domestique ? Pourquoi est-ce si mal vu pour un homme d'être efféminé ? Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin ? Il s'agit là de quelques-unes des nombreuses questions auxquelles s'intéressent les études sur le genre, devenues depuis une trentaine d'années non seulement un champ de connaissances, mais aussi un outil d'analyse incontournable en sciences humaines et sociales. Au-delà de la variété des phénomènes étudiés, l'ouvrage souligne plusieurs partis pris essentiels des études sur le genre : les différences systématiques entre femmes et hommes sont le résultat d'une construction sociale et non pas le produit d'un déterminisme biologique ; l'analyse ne doit pas se limiter à l'étude «d'un» sexe, mais porter sur leurs relations ; le genre est un rapport de domination des hommes sur les femmes, dont les modalités et l'intensité sont sans cesse reconfigurées.
Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons ? Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes ? Comment expliquer qu'elles effectuent les deux tiers du travail domestique ? Pourquoi est-ce si mal vu pour un homme d'être efféminé ? Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin ? Il s'agit là de quelques-unes des nombreuses questions auxquelles s'intéressent les études sur le genre, devenues depuis une trentaine d'années non seulement un champ de connaissances, mais aussi un outil d'analyse incontournable en sciences humaines et sociales. Au-delà de la variété des phénomènes étudiés, l'ouvrage souligne plusieurs partis pris essentiels des études sur le genre : les différences systématiques entre femmes et hommes sont le résultat d'une construction sociale et non pas le produit d'un déterminisme biologique ; l'analyse ne doit pas se limiter à l'étude «d'un» sexe, mais porter sur leurs relations ; le genre est un rapport de domination des hommes sur les femmes, dont les modalités et l'intensité sont sans cesse reconfigurées.
Broché: 358 pages
Editeur : De Boeck; Édition : 2e édition revue et augmentée (27 septembre 2012)
Collection : Ouvertures politiques
Langue : Français
ISBN-10: 2804165906
ISBN-13: 978-2804165901
Dimensions du produit: 24 x 17 x 2,4 cm
Moyenne des commentaires client : 3.7 étoiles sur 5 (7 commentaires client)
Ce manuel propose un panorama clair et synthétique des notions et références essentielles des études sur le genre, en les illustrant par de nombreux exemples concrets. Pour les étudiants, chercheurs et enseignants des 1er et 2e cycles en sociologie, anthropologie, science politique, histoire et philosophie. Laure Bereni est sociologue, chargée de recherche au CNRS. Elle enseigne à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, où elle codirige le master «Genre, politique et sexualité». Sébastien Chauvin est maître de conférences en sociologie à l'Université d'Amsterdam, directeur du Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality. Alexandre Jaunait est maître de conférences en science politique à l'Université de Poitiers et chargé de cours à Sciences Po. Anne Revillard est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité.
Extrait
Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons ? Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes ? Comment expliquer qu'elles effectuent les deux tiers du travail domestique ? Pourquoi est-ce si mal vu pour un homme d'être efféminé ? Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin ?
Il s'agit là de quelques-unes des nombreuses questions auxquelles s'intéressent les études sur le genre, qui ont connu un essor important depuis une quarantaine d'années dans un grand nombre de pays. Pour répondre à ces questions, ces études proposent une approche spécifique, dont ce manuel offre un panorama synthétique et structuré.
I. LES ÉTUDES SUR LE GENRE : DÉMARCHE GÉNÉRALE ET CHOIX THÉORIQUES
Les études sur le genre pourraient être définies, de façon très large, comme l'ensemble des recherches qui prennent pour objet les femmes et les hommes, le féminin et le masculin. Mais une telle définition ignore les apports les plus heuristiques de la riche tradition intellectuelle qui s'est développée depuis les années 1970 à proximité ou dans le sillage des mouvements féministes, et qui a donné corps à ce que nous appelons aujourd'hui les études sur le genre. En nous appuyant sur cet héritage, nous proposons de mettre en évidence quatre dimensions analytiques centrales de ce concept : le genre est une construction sociale (1) ; le genre est un processus relationnel ; le genre est un rapport de pouvoir ; le genre est imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir.
1. La première démarche des études sur le genre a été de faire éclater les visions essentialistes de la différence des sexes, qui consistent à attribuer des caractéristiques immuables aux femmes et aux hommes en fonction, le plus souvent, de leurs caractéristiques biologiques. La perspective anti-essentialiste est au coeur de la démarche de Simone de Beauvoir, quand elle écrit dans Le deuxième sexe, en 1949 : «On ne naît pas femme : on le devient»3. Il n'y a pas d'essence de la «féminité», ni d'ailleurs de la «masculinité», mais un apprentissage tout au long de la vie des comportements socialement attendus d'une femme ou d'un homme. Autrement dit, les différences systématiques entre femmes et hommes ne sont pas le produit d'un déterminisme biologique, mais bien d'une construction sociale.
2. La deuxième démarche des études sur le genre a été de prôner une approche relationnelle des sexes, car les caractéristiques associées à chaque sexe sont socialement construites dans une relation d'opposition (cf. encadré n° 1). Dès lors, on ne peut étudier ce qui relève des femmes et du féminin sans articuler l'analyse avec les hommes et le masculin. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les études sur le genre s'intéressent donc tout autant aux femmes et au féminin qu'aux hommes et au masculin. L'adoption d'une posture relationnelle ne signifie pas qu'on ne peut pas travailler de manière privilégiée sur l'un des groupes de sexe. Historiquement, les recherches féministes ont été largement consacrées à l'étude des expériences sociales des femmes, dans une perspective «compensatoire» face à des savoirs disciplinaires qui, prétendant étudier des individus abstraits, se sont en pratique majoritairement focalisés sur les hommes et le masculin. Un grand nombre des recherches menées «sur les femmes» relève d'une perspective relationnelle, c'est-à-dire envisage les femmes et le féminin comme le produit d'un rapport social. De même, un certain nombre de recherches sur les hommes et masculinités s'inscrivent dans l'héritage des recherches féministes et sur le genre, et adoptent cette posture relationnelle.
Note d'intention de l'autrice : Dans mes œuvres, vous aurez remarqué une constance singulière : l'utilisation des mêmes prénoms et parfois des mêmes caractères pour mes personnages. Cette méthode est une invitation à une expérience de lecture que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Imaginez-vous un instant dans le monde du cinéma. Lorsque nous apprécions une actrice ou un acteur, nous sommes tentés de suivre leur carrière, découvrant des rôles variés dans des films aux contextes distincts. Cette continuité crée un fil d'Ariane émotionnel, reliant des œuvres par une présence familière.
De la même manière, dans mes romans, les personnages portent parfois les mêmes prénoms et noms. Cette récurrence est une invitation à explorer différentes facettes d'une personnalité et des existences, à la voir évoluer dans des contextes, des époques et des intrigues variées.
Cette approche est ma manière de les imaginer, de créer un univers littéraire où chaque histoire est liée par des fils invisibles. Je vous convie donc à plonger dans ces œuvres distinctes comme dans une toile inédite où se révèlent les portraits des femmes qui m’inspirent…
MENU EBOOKS LESBIENS
Nos articles les plus consultés
- Les meilleurs livres et romans lesbiens de Kyrian Malone
- Où lire un roman lesbien GRATUIT ? Allez sur Wattpad
- Escort Girl - double réédition du roman lesbien érotique
- Les tomes 5 et 6 de "The Underworld Chronicles" sont en ligne
- Romance lesbienne : "Madame Queen Stanford", en ebook et papier
- La saga lesbienne "Underworld Chronicles" terminée
- Le fan-cast de "Loving Clarke" et "Requiem" (thriller lesbien)
- Thriller lesbien : "Embrase-moi", une romance lesbienne féministe !
- Nouvelle fanfiction lesbienne de l'univers "Buffy" ajoutée
- Les meilleurs livres lesbiens de 2021
Nos Romans Lesbiens
PROCHAINEMENT
- Nuit Blanche à White River (2025)
- Possède-moi (2025)
- La vipère et la Rose (2026)
- Désir coupable (2026)
- Sous les cendres de Kendahar (2026)
- A Kiss for Christmas (2026)
- Piece of love (2027)
- Underworld CHAOS (Spin-off 2027)
- Toxic Romance (2028) - 2.5 mains
KYRIAN MALONE SOLO
- Au fil des jours
- Alien Némésis
- Bad Girls
- Belle et Venimeuse
- Ce désir dans nos veines
- De cendres et de sang 1
- De cendres et de sang 2
- Fallen Angel
- Exode 1 et 2
- Exode 3
- Guide de survie en territoire lesbien
- Have Faith - Tome 1
- Into the Dark - Saison 1
- Into the Dark - Saison 2
- IMMORTELLE 1
- IMMORTELLE 2
- IMMORTELLE 3
- IMMORTELLE 4
- IMMORTELLE 5
- KISS & RUN
- Kill the Terf
- Listen to your Heart
- Loving Clarke 1
- Loving Clarke 2
- Loving Clarke 3 ![]() (ebook)
(ebook)
- Loving Clarke 4 ![]() (ebook)
(ebook)
- Loving Clarke 5 ![]() (ebook)
(ebook)
- Loving Clarke 6 (Lilith 1)
- Loving Clarke 7 (Lilith 2)
- Lucifer ~ Origine
- Madame Queen Philadelphie
- Madame Queen New York (Embrase-moi)
- Madame Queen Stanford 1
- Madame Queen Stanford 2
- Madame Queen Stanford 3
- Madame Quinn - Mémoire Morte 1 ![]()
- Madame Quinn - Mémoire morte 2 ![]()
- Paranormal
- Porn Star
- Possède-moi ![]()
- Sentiment troublant 1
- Sentiment troublant 2
- Serial Killer - Tome 1
- Sanctuaire
- The Underworld Chronicles 1
- The Underworld Chronicles 2
- The Underworld Chronicles 3
- The Underworld Chronicles 4
- The Underworld Chronicles 5
- The Underworld Chronicles 6
- The Underworld Chronicles 7
- The Underworld Chronicles 8
- The Underworld Chronicles 9
- The Underworld Chronicles 10
- The Underworld Chronicles 11
- The Lady in Red ![]()
- Tueuses
- Undead Legacy 1 + 2
- Undead - tome 1 (annulé)
- Undead - tome 2 (indépendant du 1)
- Undead - tome 3
- Undead - tome 4
- Undead - tome 5
- Une nuit avec toi ![]()
Romans à 4 mains
- Sentiments interdits (Lena Clarke)
- Nos âmes égarées (Lena Clarke)
- Madame la Présidente (Charlie Moon)
KYRIAN MALONE & JAMIE LEIGH
- A toi pour toujours
- Cold Case
- Déteste-moi Tant que je t'aime
- De Guerre, d'Amour et de Sang 1
- De Guerre, d'Amour et de Sang 2
- De Guerre, d'Amour et de Sang 3
- De Guerre, d'Amour et de Sang 4
- De Guerre, d'Amour et de Sang 5
- De Guerre, d'Amour et de Sang 6
- De Guerre, d'Amour et de Sang 7
- De Guerre, d'Amour et de Sang 8
- De Guerre, d'Amour et de Sang 9
- Escort Girl
- Gina
- Guilty Pleasure
- IEUF, la Reine et la Voleuse - Tome 1
- IEUF, la Reine et la Voleuse - Tome 2
- IEUF, la Reine et la Voleuse - Tome 3
- IEUF, la Reine et la Voleuse - Intégrale
- Love Is Weakness
- Madame Queen
- Mon Amie, mon Amour, mon Amante
- Remember Me
- Serial Killer - Tome 2
- Serial Killer - Tome 3
- Serial Killer - Tome 4
- Serial Killer - Tome 5
- Serial Killer - Tome 6
- Serial Killer - Tome 7
- Serial Killer - Tome 8
- Serial Killer - Tome 9
- Serial Killer - Tome 10 (Final)
- Seriak Killer - V.E.R.S.U.S.
- Sisters
- Survivors - réadaptation 2014
- Undead - Tome 1
- Valkyrie - tome 1
- Word Trade Center Intégrale 2015
JAMIE LEIGH (SOLO)
Romans dépubliés devant être réédités : 22

